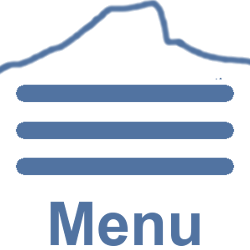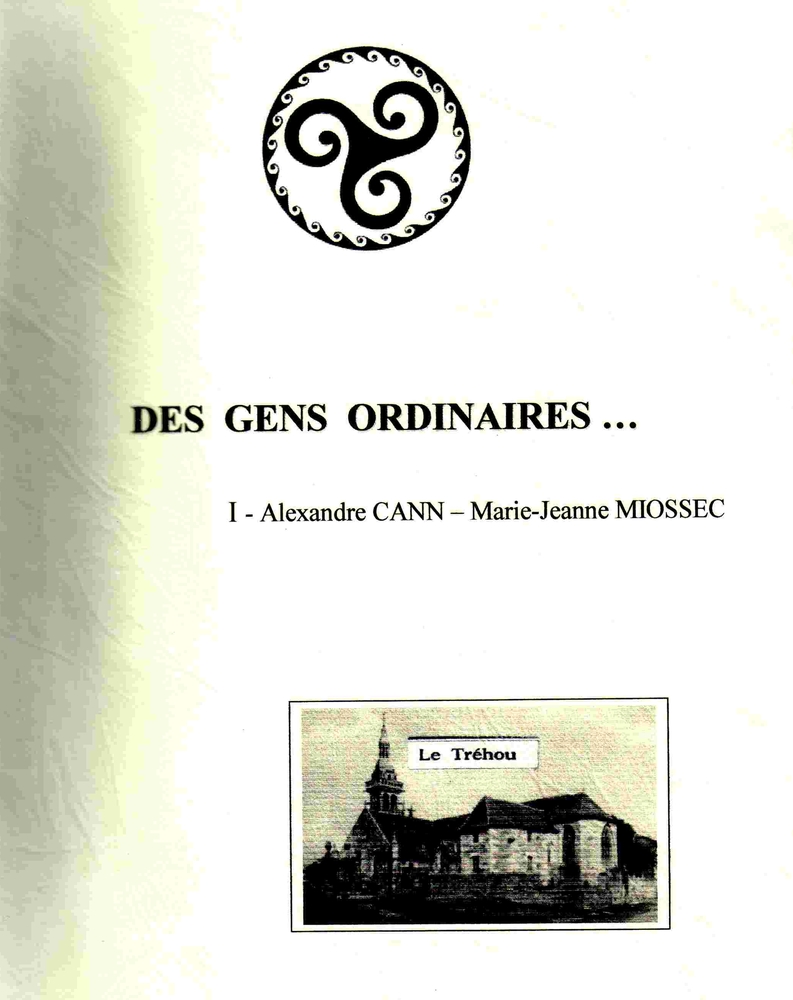| ← | 1842-1903 : Marguerite Le Moigne |
Marguerite Le Moigne, une de mes arrière-arrière-grands-mères maternelles...
Extraits d’une généalogie familiale rédigée par Jeannette Cann, arrière-petite-fille de Marguerite Le Moigne.
Jeannette a récolté de nombreux témoignages auprès de sa famille et, à l’occasion d’une cousinade au Tréhou, en a fait un livre.
L’extrait ci-dessous provient de conversations entre Jeannette et sa mère.
Les notes dans la marge sont de l’auteur.
[…] Elle s’était mariée jeune. À seize ans. Et son mari, Louis Cann, 20 ans !
Sur sept enfants nés de leur union, seuls quatre sont encore en vie. Les naissances s’étaient fait attendre. Marie-Angèle, premier enfant après cinq ans de mariage ! Marie-Angèle, enfin !
Elle ne vécut pas.
Il se passa encore cinq ans avant que vienne au monde Marie-Jeanne, solide et beau bébé. Marie-Jeanne disparut tragiquement à l’adolescence.
Alexandre naissait quatre ans plus tard, et comme si la nature se réveillait face au temps qui passe, François en 1874, en 1879 Marguerite que l’on appela Ma’harite pour la distinguer de sa mère, puis Jean-Marie en 1880.
En 1882 Jean-Pierre. Marguerite avait 40 ans. Comme son premier enfant, ce dernier mourut au bout de quelques jours.
Elle habitait Leuzeureugan.
Leuzeureugan est un village à cheval sur les communes du Tréhou et de Ploudiry. Plusieurs familles y vivaient dont la sienne à Leuzeureugan vian*, sur la commune du Tréhou. […]*. Bihan : petit ; vihan : petite.
Marguerite Le Moigne était née à Voasvarec. […]
C’est après son mariage, en 1858, qu’elle était venue vivre à Leuzeureugan, chez ses beaux-parents et leurs cinq enfants encore très jeunes.
— Tu veux dire encore mineurs ?
— Mineurs, majeurs...Autrefois cela ne voulait pas dire grand-chose. C’est l’âge auquel on commençait à travailler qui comptait !
— Quel âge avaient les enfants quand elle arriva à Leuzeureugan ?
— Son mari, Louis-Joseph, pour le distinguer de son père, Louis sans autre prénom, avait 20 ans. Donc mineur, comme tu dis, mais considéré comme un homme, compte tenu du travail qu’il assumait. Un autre garçon, Yves, qui avait 10 ans, et quatre filles, Marie-Anne, 19 ans, Marie-Josèphe, 14 ans, Marguerite, 7 ans et Marie-Françoise, 2 ans...
— Deux ans ! Un bébé !
— Oui, presque. Et on peut facilement imaginer que c’était un grand changement pour Marguerite Le Moigne de se retrouver au milieu de cette marmaille ! Avant son mariage, elle vivait avec ses parents et ses deux sœurs : Angèle et Marie. […]
Marguerite était donc habituée à une vie plus facile que celle qu’elle allait mener à Leuzeureugan.
— Mariage arrangé, tu crois ?
— Non... […]
— Elle était d’une famille relativement aisée. Ces « Le Moigne » venaient de Ploudiry... ou La Martyre... […]
Ils donnèrent à leur fille Marguerite, […], une dot de 2 400 francs en pièces métalliques...
— En pièces d’or !!!
— Certainement ! Pour partie au moins. […]
— Pas de doute, c’est précisé dans le contrat de mariage. 1200 francs le 1er janvier 1859 et les autres 1200 francs le 1er janvier 1860. […] Le mariage a eu lieu en 1858, le 3 novembre précisément.
— Ça faisait beaucoup d’argent...
— La valeur de quatre bœufs, à peu près. Comme la somme a été donnée en deux fois, on peut penser que le père de la mariée a vendu deux bœufs pour faire le premier versement, puis deux autres un peu plus tard. Car ce serait étonnant qu’ils aient eu autant d’économies. Ce n’était pas des richards ! Et 2 400 francs... même en deux fois, c’était beaucoup.* *. 3 ans plus tard, il y a eu un inventaire au décès du beau-père de Marguerite pour garantir les biens des enfants mineurs. L’actif s’élevait alors à 8000 francs, a peu près. Il était composé essentiellement de bétail (5 vaches, 5 bœufs, 2 chevaux).
— Je crois savoir que le fermage payé au propriétaire d’alors pour Leuzeureugan était de 500 francs par an.
— Qu’est-ce qu’ils ont fait de l’argent, à ton avis ?
— Ils n’ont pas acheté la ferme. Ça c’est sûr, puisqu’en 1900 ils étaient toujours fermiers. Du matériel peut-être... […]
— Et le marié, d’après le contrat, qu’est-ce qu’il apportait ?
— Nentra ! Nentra toud !* *. Rien ! Rien du tout !
— Rien ! Il devait avoir quelque chose pour lui ce jeune homme ! Quelque chose que nous ignorons ! Ou alors, Marguerite était une idiote ! Se marier à 16 ans, pour aller vivre avec sa belle-mère et ses marmots... Quand on peut faire autrement...
— À moins que...
Je ne sais laquelle avait émis ce doute, qui, s’il se révélait exact, entachait l’honneur de notre aïeule... Toujours est-il que très vite nous avons abandonné cette supposition osée.
Maman s’était empressée de me faire remarquer que le premier enfant n’était arrivé qu’après cinq ans de mariage. Ni l’une ni l’autre n’avons évoqué les possibilités de fausses couches...
Marguerite avait su plaire à notre ancêtre de la lignée des Cann. À ce Louis Cann, qui, à voir sa belle écriture au bas des actes, avait été à l’école. Son père aussi d’ailleurs. N’est-il pas fait mention de livres dans cet inventaire de 1851. Comme nous aurions aimé savoir quels étaient ces livres ! Les titres ! Tout ce que nous savons les concernant c’est qu’ils ont été estimés à 5 francs, autant qu’un joug à bœufs avec ses courroies !* *. Ou 4 râteaux et 8 crocs à fumier... ou 16 écuelles en terre et 16 cuillers en bois...
Marguerite, elle, ne savait pas signer. Il est vrai qu’à cette époque peu de filles allaient à l’école. Mais son père non plus n’a pas laissé de traces d’écriture au bas des actes.
— Cela ne veut pas dire que Marguerite était débile ! Sa descendance est là pour prouver que tous sont sains de corps et d’esprit !!! Et mon grand-père ne l’a certainement pas épousée pour sa dot, ça se serait su. D’ailleurs les Cann n’étaient pas connus pour des gens d’argent, mais estimés pour leurs qualités morales.
Le ton était catégorique.
— Alors, dans le contrat ça ne peut pas figurer, mais il apportait le savoir, l’instruction... Est-ce que ça compensait l’apport dans le ménage des pièces d’or ou d’argent ?
C’était aller un peu loin dans les suppositions...
— Si tout simplement ils avaient été amoureux... Cela devait bien se produire, même « gwechall » !* *. Autrefois.
— Bien sûr, ça existait ! On n’en parlait pas de cette façon ! C’est tout !
— Qu’est-ce qu’on disait ?
— « Se plaire ». Ça suffisait.
Donc, ils s’étaient plus. Le chapitre était clos.
Peu après le mariage de Marguerite et de Louis, Marie-Anne, sa jeune belle-sœur épousait Jean-Pierre Crenn et allait habiter Sizun.
En 1861, quand son beau-père mourut, restaient au foyer, sa belle-mère et ses quatre jeunes beaux-frères et belles-sœurs.
La vie s’était organisée autour du travail.
Mais Marguerite, dans l’attente d’une maternité réussie, regrettait la vie qu’elle menait précédemment avec ses sœurs. Seule la présence de Louis et les égards qu’il avait pour elle lui donnaient une sensation de bonheur. Il lui fallut attendre 1868 et la certitude que l’enfant qui venait de naître était une réalité bien vivante pour qu’elle s’estime heureuse.
Le temps avait passé.
Les habitants de Leuzeureugan se tournaient de plus en plus vers Sizun, le bourg le plus accessible. Les enfants habitués très jeunes à conduire des attelages se chargeaient volontiers des déplacements. Marie-Jeanne, fille ainée de Marguerite et de Louis, allait une fois par semaine porter la pâte à pain au boulanger de Sizun qui en assurait la cuisson dans le four communal.
Ce jour-là était un jour comme un autre. Et pourtant ! Le cheval s’emballa dans la descente du Ros, ancienne voie romaine volontiers empruntée. Marie-Jeanne, éjectée de la charrette, mourut écrasée par les roues de son attelage. Elle n’avait pas seize ans.
De ce jour, rien ne fut plus pareil à Leuzeureugan. Marguerite pleurait son aînée et reportait son amour maternel sur Ma’harite, la fille qui lui restait.
Elle aimait ses garçons.
— Mais les garçons, ce n’est pas pareil disait-elle. On ne parle pas avec eux des mêmes choses.
Alexandre, François, et Jean-Marie se tournaient vers l’extérieur. À l’école ils apprenaient vite et bien. Tout les intéressait. Mais ils en parlaient peu, sauf entre eux ou avec leur père. Alexandre ne dira-t-il pas, bien plus tard que son père avait été son modèle.
Aussi, Alexandre se retrouva-t-il d’autant plus orphelin lorsque son père mourut. Il devait exploiter la ferme. Ses deux frères n’avaient que 20 et 14 ans. Des garçons qui ne cachaient pas le peu de goût qu’ils avaient pour le métier d’agriculteur.
François envisageait de transporter le courrier pour le compte de l’Administration des Postes. Emploi pour lequel il avait postulé. Il n’attendait plus que l’acceptation de son dossier, sûr de devoir commencer bientôt.
— Il me suffira d’un attelage, disait-il.
Comme Alexandre lui faisait remarquer qu’il fallait assumer ce travail journellement, sans la moindre défaillance, François précisait :
— Jean-Marie, s’il le faut absolument pourra toujours me remplacer ! Même toi !
Jean-Marie opinait, heureux de cette perspective.
— Le reste du temps on t’aidera à la ferme !
Comment refuser à ses frères ce que lui ne pouvait pas envisager ? Il était l’ainé.
Il s’absorbait dans son travail, mesurant tous les progrès qu’il restait à faire pour améliorer la condition paysanne.
Sa sœur Ma’harite, proche de ses 17 ans, aidait leur mère aux tâches habituellement dévolues aux femmes.
Les amis de son père étaient devenus les siens. Ils avaient des idées pouvant paraître avancées, parfois révolutionnaires. Alexandre aimait les écouter. Il a été à l’école. Celle des laïques. Depuis, il a continué à lire, à réfléchir. Son père lui avait fait prendre conscience de la valeur de la citoyenneté en lui parlant de la Révolution et de ses conséquences.
Les idées de ses amis de Sizun n’étaient pas des idées nouvelles pour lui. Seulement, lui, il était paysan, moins instruit. En plus, il habitait ce pays perdu qu’était Leuzeureugan. […]
| →→ 1859 : Allain Kerneis s’en va-t-en guerre →→ |